Parcours Développement agricole et politiques économiques
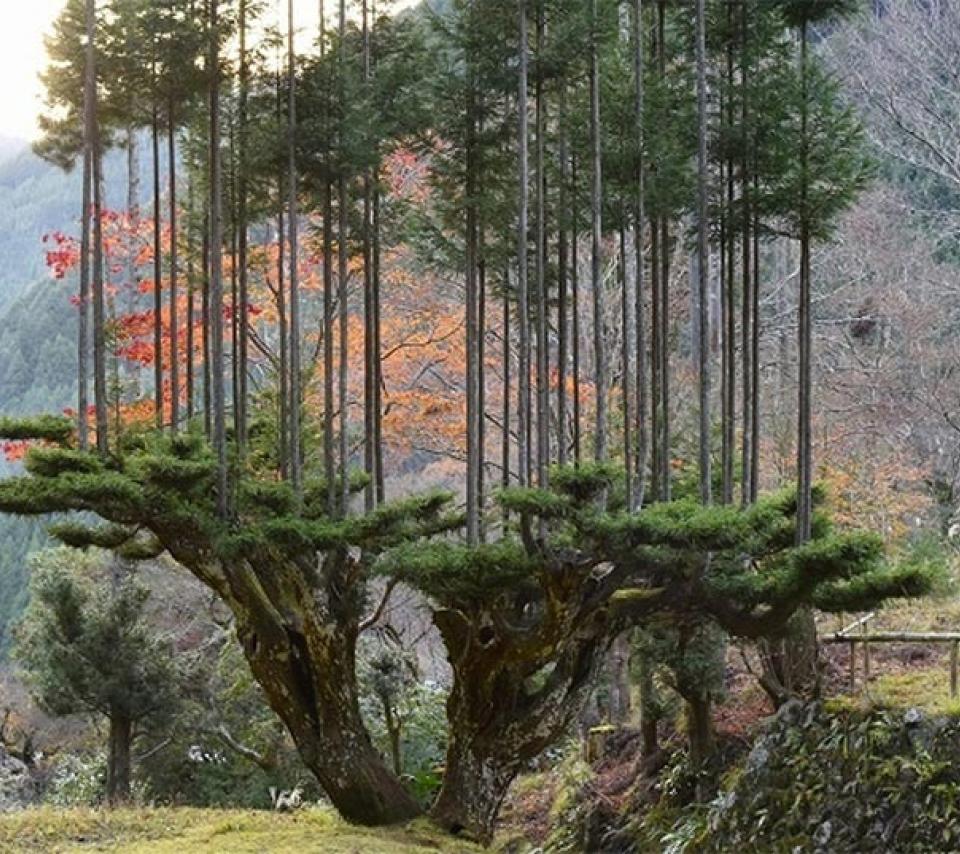
En 2008 déjà, les émeutes de la faim et les crises alimentaires au Sahel et dans d’autres zones ou pays en développement avaient remis en exergue - au regard des bailleurs de fonds, des institutions internationales et des gouvernements notamment - l’importance de politiques publiques davantage orientées vers le soutien d’une agriculture (majoritairement familiale) plus durable, pour assurer la souveraineté et la sécurité alimentaires, gages de stabilité pour les pays et de bien-être pour les populations. Le début de l’année 2020 marqué par la crise sanitaire du Covid-19 et les multiples répercussions économiques qui ont suivi cette pandémie mondiale remettent une nouvelle fois l’agriculture, nos modes d’alimentation et notre rapport au monde du vivant au coeur des enjeux du 21ème siècle. Pour répondre également aux enjeux du réchauffement climatique que nul ne peut désormais nier et atteindre les Objectifs de Développement Durable, la nécessité d’un développement agricole durable et solidaire apparaît aujourd’hui comme une évidence.
L’ensemble des enseignements du parcours « Développement agricole et politiques économiques » et l’expérience en milieu professionnel sont conçus afin d’apporter des connaissances approfondies sur les enjeux agro-environnementaux contemporains, les méthodes de diagnostic des situations agro-économiques et pour situer les politiques agricoles, dans les pays développés ou en développement, dans le contexte des relations internationales afin d’appréhender les contraintes que font peser les forces économiques sur le processus de développement agricole.
L'économie mondiale met en concurrence des agricultures inégalement développées et différenciées. La compréhension des inégalités suppose une bonne connaissance des origines et des transformations de l'agriculture des différentes parties du monde. L’analyse des contraintes et des enjeux auxquels doivent faire face les exploitations agricoles aux différents niveaux - local, national et international - , permettent de saisir les différentes facettes du processus de développement agricole. Aussi, la formation à la théorie et aux méthodes propres au domaine agricole s’accompagne d’une formation aux fondamentaux des principales disciplines des sciences sociales du développement. Ces fondamentaux sont pris en charge par les enseignements du tronc commun de la Mention « Etudes du développement » mais le parcours les complète par un enseignement plus approfondi des problématiques agro-environnementales (cf. Maquette des enseignements dans les tableaux ci-dessous) pour comprendre les transformations en cours dans l’agriculture contemporaine et formuler un diagnostic sur les politiques et les projets agricoles.
↓ Télécharger en cliquant ici la brochure du parcours ↓
→ Accéder à l'offre de formation de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
-
Objectifs pédagogiques du parcours
L’objectif principal est de préparer des professionnels capables d'intervenir dans l'étude de l'agriculture, de ses problèmes et de leur solution dans une région ou un pays au sein d’organismes sectoriels, locaux, nationaux. La formation vise également à fournir aux étudiant.e.s les moyens d’analyser les grandes problématiques de développement agricole international.
Il s’agit donc
- d’introduire les notions théoriques et les outils méthodologiques de base pour comprendre le fonctionnement des marchés agricoles mondiaux, les problèmes de développement agricole tels qu'ils se posent au niveau des unités de production d'une région agricole,
- de montrer en quoi les réformes des politiques agricoles et les négociations commerciales multilatérales conditionnent concrètement le développement de l’agriculture dans diverses parties du monde.
- d’étudier et illustrer les différents systèmes agraires grâce à la lecture et à la discussion de travaux d’origine pluridisciplinaire et d’études de cas ;
- d’appréhender les tensions sur l’accès aux ressources (foncières, alimentaires etc.) qui sont sources de conflits et/ou de crises.
La discipline dominante de ce parcours est l’économie, avec un ancrage fort sur les autres disciplines de Sciences Humaines et Sociales.
-
Accès et organisation du parcours
Le parcours « développement agricole » accueille un effectif d’environ 24 étudiant.e.s, français.e.s ou étrangers.ères, par promotion. Elle s’adresse à trois types d’étudiant.e.s :
- celles et ceux qui ont un cursus universitaire classique, notamment en sciences sociales (économie, géographie, démographie, histoire, sociologie, anthropologie et AES), de préférence déjà orienté vers l’étude des pays en développement ;
- celles et ceux qui relèvent d’autres disciplines (sciences politiques, philosophie, lettres, droit) et les ingénieur.e.s (agronomes ou d’autres spécialités) et présentent un dossier prouvant leur intérêt pour la question du développement (mémoire, stage, choix des matières, engagement associatif, bénévolat, séjours significatifs dans un pays du sud, apprentissage d’une langue vernaculaire).
- celles et ceux qui ont déjà une expérience professionnelle avérée dans le champ du développement et qui souhaitent acquérir ou réactiver des outils analytiques, conceptuels et méthodologiques qui leur permettront de progresser dans leur métier.
La validation d’acquis professionnels est possible selon les modalités en vigueur. Le/la candidat.e devra faire la preuve que ces acquis professionnels sont liés aux thèmes développés dans le parcours.
La sélection pour l’entrée en Master 1ère ou 2ème année se fait sur dossier. Le/la responsable du parcours peut le cas échéant convoquer des étudiant.e.s pour un entretien s’il le juge nécessaire.
-
Parcours de formation > Validation
Parcours de formation et organisation des enseignements
Semestre 1 : ce semestre est commun à tous les parcours du Master mention « Études du développement » de l’IEDES. Il vise à l’acquisition de « fondamentaux » nécessaires à l’étude et à l’action dans le domaine du développement. Ce premier semestre commun à tous les parcours de Master de l’IEDES favorise également la consolidation d’une culture générale scientifique, voire de mise à niveau. Dans l’UE 2 (Analyse socio-économique du développement), l’étudiant.e personnalise son parcours par le choix de 10 crédits ECTS parmi les cours proposés ; seul le cours de micro-économie du développement est obligatoire dans le parcours « développement agricole » pour cette UE, les autres étant au choix de l’étudiant.e. Si deux cours de Sciences Humaines et Sociales sont choisis dans cette UE 2, le TD est obligatoire.
Semestre 2 : A la fin du premier semestre de tronc commun, les étudiant.e.s qui en font la demande motivée, sur la base des enseignements suivis en semestre 1 et de leurs projets professionnels, peuvent être orientés vers ce parcours. Durant le deuxième semestre, les étudiant.e.s suivent des enseignements de tronc commun (UE n°1) et des enseignements du parcours « développement agricole » du Master.
Semestre 3 : Selon les mêmes dispositions d’orientation qu’à la fin du premier semestre, les étudiant.e.s qui poursuivent dans ce parcours de Master entrent en semestre 3 du parcours pour suivre 3 UE pour un total de 30 crédits. La personnalisation du parcours de l’étudiant.e s’opère au moyen d’une option libre.. Des cours optionnels peuvent être proposés prioritairement aux étudiant.e.s et intégrés dans leur planning.
Semestre 4 : Une expérience en milieu professionnel obligatoire de 3 à 6 mois (3 mois minimum) est intégrée dans la formation pour un total de 30 crédits. Etape centrale de la formation, cette expérience doit préparer l’étudiant.e à s’insérer dans le milieu professionnel. La définition du projet de l’étudiant.e, la recherche, la réalisation du stage (ou toute autre forme de contrat de travail, de volontariat) et la rédaction du rapport sont étroitement définis en fonction des besoins des organismes intervenants sur le terrain. La recherche de la structure d’accueil pour cette expérience professionnelle est effectuée par l’étudiant.e. La personne chargée des Relations avec les entreprises et de l’insertion professionnelle (Reip) de l’IEDES aide l’étudiant.e dans la formulation de son projet professionnel (rédaction de CV et de lettre de motivation, mise à disposition d’une base de données sur les organismes susceptibles d’accueillir des stagiaires). Cette expérience professionnelle peut être effectuée en France ou à l’étranger à partir du mois de février, pour une durée maximale de 6 mois. Une convention de stage devra être signée entre l'IEDES et l'organisme d'accueil, selon les règles communes de l’Université de Paris I.
Les enseignements de S2 et S3, leurs volumes horaires et les coefficients sont présentés dans les maquettes accessibles ci-après. L’assiduité aux enseignements est obligatoire. Le quatrième semestre S4 est entièrement consacré à l’expérience en milieu professionnel et à la rédaction du rapport individuel correspondant pour un total de 30 crédits.
- Maquette des cours de Master 1 (M1) 2024-2025
- Maquette des cours de Master 2 (M2) 2024-2025
- Règlement de contrôle des connaissances
Validation de la maîtrise d'une langue étrangère
Cette validation est obligatoire dans le cadre des masters.
Le TD de langues est obligatoire en S1 de M1, à l’exception des étudiant.e.s présentant un diplôme spécifique de langue ; la note d’examen final sert de base à la validation, qui est donc incluse dans l’ensemble des crédits (pour 2 ECTS). Le volume horaire du TD de langue, obligatoire, est comptabilisé en S1 de M1.
Deux cas de figure sont possibles :
- les étudiant.e.s qui choisissent l’anglais se voient proposer un TD par le département des langues de l’université Paris 1qui dédié aux étudiant.e.s de l’IEDES.
- les étudiant.e.s qui choisissent une autre langue, enseignée également par le département des langues de l’université Paris 1, espagnol, italien, allemand, portugais, arabe, russe, chinois (sous réserve pour ce dernier), se voient offrir la possibilité de suivre un enseignement par ces services. Ils peuvent également, sous réserve de l’accord du/de la directeur.trice du parcours, choisir de valider leur connaissance d’une autre langue, certifiée par une autre institution (par exemple l’INALCO pour les langues « orientales »).
Les étudiant.e.s entré.e.s directement en S2 de M1, ou en M2, doivent présenter une certification de leur maîtrise d’une langue étrangère obtenue dans le M1 qu’ils ont suivi ; à défaut de celle-ci, ou de la possession d’un diplôme spécifique de langue, ils pourront suivre un TD de langues dédié aux étudiant.e.s de l’IEDES (anglais) durant le 1er semestre de M2 (test de niveau au 1er TD) s’ils le désirent et passeront obligatoirement un examen de langue en même temps que les M1.
-
Equipe pédagogique
• ANGELOFF Tania, Professeur, Université Paris 1-IEDES
• BAINVILLE Sébastien, enseignant-chercheur, Institut des Régions Chaudes, Montpellier
• BERTHELOT Valérie, Maître de conférences, AgroParisTech
• BLANC-ANSARI Jordie, Maître de conférences, Université Paris 1 - IEDES
• CAPITANT Sylvie, Maître de conférences, Université Paris 1 - IEDES
• CUSSÒ Roser, Professeur, Université Paris 1-IEDES
• DELESALLE Esther, Maître de conférences, Université Paris 1 – IEDES
• FARE Yohann, Kinomé, Responsable filières durables
• GILLOT Gaëlle, Maître de conférences, Université Paris 1 - IEDES
• GUÉNARD Charlotte, Maître de conférences, Université Paris 1 - IEDES
• HÉTROIT Arnaud, directeur du Commerce du Bois
• HOUNGBEDJI Kenneth, chargé de recherche IRD, UMR LEDa, équipe DIAL
• JACQMIN Christophe, Inter-Réseaux Développement rural
• JANIN Pierre, Directeur de recherche IRD, UMR 201 « Développement et Sociétés »
• JOBBÉ-DUVAL Benoît, Directeur Général, Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
• LEVARD Laurent, Chargé de programmes, GRET
• LE NAËLOU Anne, Maître de conférences, Université Paris 1 – IEDES
• LUROIS Raphaël, directeur de Semer l'Avenir, affilié au Réseau national des Écoles de la Transition Écologique (ETRE)
• MAKROUF Youssef– Chargé de programmes IRAM
• MOYNOT Gilles, Directeur technique, ONF International
• PERDRIAULT Mathieu, Chargé de développement et des projets, aGter
• PINGEL Isabelle, Professeur, Université Paris 1
• POUCH Thierry, service Références et études économiques, agricultures et territoires, Chambres d'agriculture, chercheur associé à l'Université de Reims Champagne Ardenne
• RAFFRAY Marine, chargée de missions, Service Etudes, références, prospectives, Chambres d'agriculture
• RIVIÈRE Miguel, Ingénieur des Ponts, Eaux et Forêts, docteur en économie, chercheur au CIRED
• ROGER-ESTRADE Jean, Professeur AgroParisTech
• SPIELVOGEL Gilles, Maître de conférences, Université Paris 1 – IEDES
• STOLL Julie, Déléguée Générale, Commerce Équitable France
• TCHAGA Flavien, économiste, consultant
• TOULOUSE Benoît, géographe, Paris Habitat
• VALCESCHINI Egizio, Directeur de recherche INRAE, Président du Comité d’histoire INRAE/CIRAD
• YELKOUNI Martin, Directeur Général, Institut d'Appui au Développement -
Descriptif des cours
Cours de Semestre 2 (Master 1)
Acteurs et institutions de l’aide (Anne Le Naëlou, coord.)
Constitué de quatre parties, ce cours vise à présenter les acteurs de l’APD mondiale et française, la lente construction d’une Politique européenne de développement et la place montante des acteurs non souverains ONG et Fondations). Les intervenants privilégient les évolutions des mandats, dispositifs et des champs d’interventions de ces différents niveaux de l’aide et les débats en interne et externes qu’ils suscitent.
Conférences professionnelles et sociales dans le domaine du développement (Gaëlle Gillot, coord.)
Des intervenant.e.s professionnel.le.s viennent présenter leurs parcours et expériences professionnels. Ils exposent de manière critique et interactive avec les étudiant.e.s, leurs métiers actuels, leurs organismes employeurs, les évolutions qui concernent leur pratique professionnelle et plus largement le domaine de l’aide et du développement. Mêlant des profils plus ou moins expérimentés, ce cycle de conférence invite majoritairement des anciens IEDESsien.ne.s avec lesquels les échanges se révèlent très constructifs pour l’élaboration des projets professionnels des étudiant.e.s de Master 1.
Négociations internationales autour de la mise en oeuvre des ODD (coord. IDDRI & A. Le Naëlou)
Sur la base d’un panorama des négociations internationales récentes et/ou en cours, l’objectif de ce module est de pointer les déterminants d’une négociation internationale dans le domaine du développement durable et de mettre les étudiant.e.s en capacité de comprendre et d’analyser les constructions des positions par les parties prenantes et d’envisager les alliances entre acteurs possibles.
Séminaire central : Caractérisation et enjeux des systèmes agroécologiques face aux changements globaux (C. Guénard)
L'accroissement des besoins des sociétés à long terme en matière d'alimentation, d'énergie, et de produits issus des écosystèmes, fait que l'activité agricole pose des problèmes environnementaux, économiques et sociaux nouveaux. Les formes et les techniques de l'agriculture actuelle ne seront plus adaptées. Le cours répondra à la question de savoir comment définir une agriculture durable, c'est-à-dire socialement, économiquement, et environnementalement viable.
Après avoir caractérisé les alternatives aux systèmes intensifs et consommateurs d’intrants chimiques (non labour, permaculture, agroforesterie, agriculture biologique, agriculture de conservation,…), le séminaire aborde, sous la forme de dossiers thématiques et de séances interactives voire co-construites, les enjeux (pression démographique, dégradation de la fertilité des sols, besoins en main d’œuvre, en eau etc.) auxquels font face les systèmes agricoles actuels dans différents contextes géographiques. Il s’attachera à étudier les avantages et désavantages de différents modèles (petite agriculture familiale, agro-industrie, agriculture contractuelle), de différentes pratiques agroécologiques et à mettre en évidence la nécessaire adaptation des agricultures aux changements globaux en cours (changement climatique, croît démographique, urbanisation etc.). Enfin, différents dossiers pourront être dédiés aux outils et aux politiques publiques - d’atténuation, d’adaptation, ou mixtes - impulsées dans les décennies récentes pour faire face à ces changements ainsi qu’à la question des échelles d’interventions pertinentes (terroirs, filières, territoires etc.).Agriculture et relations internationales (L. Levard, coord.)
L’activité agricole est de plus en plus influencée par les décisions internationales dans les pays développés et en développement. En effet, un céréalier du bassin parisien a une partie de son revenu qui se décide à Bruxelles alors qu’un cotonnier de la vallée du Niger au Mali attendra les négociations entre son pays et la Banque mondiale pour savoir le niveau de rémunération auquel il aura droit. L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiant.e.s aux liens entre l’agriculture et son environnement international. Ainsi seront notamment étudiés les échanges et marchés internationaux de produits agricoles, la question de la volatilité des prix agricoles mondiaux, les règles relatives aux échanges internationaux (accords commerciaux et règles privées) et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et alimentaires du point de vue des agricultures des pays du Sud.
Développement rural (en cours d’organisation – discipline et contenu)
Tensions foncières (M. Perdriault)
L'enseignement traitera des questions relatives à l'environnement foncier du développement local selon une approche socio-économique. Basé sur des exemples de l'Afrique Noire, d’Amérique du Sud ou d’Europe, il privilégiera une analyse des questions d'accès à la terre, des représentations et des effets de la répartition du foncier sur le développement local, en tenant compte des déterminants aux échelles nationale et internationale.
Introduction au droit de l’union européenne, mention agriculture (I. Pingel)
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiant.e.s avec le droit de l’organisation. A cette fin, il se propose de leur présenter, d’une part, les textes fondamentaux sur la base desquels l’Union est organisée, et plus particulièrement ce qu’il est encore aujourd’hui convenu d’appeler le traité de Rome. Le cours sera l’occasion, d’autre part, de découvrir les institutions essentielles qui permettent à l’Union européenne de fonctionner et le modèle de collaboration qui est le leur. De manière à respecter au plus près l’objectif principal de la formation (préparer des professionnels capables d'intervenir dans l'étude de l'agriculture, de ses problèmes et de leur solution dans une région ou un pays au sein d’organismes sectoriels, locaux, nationaux), les questions juridiques seront étudiées à partir d’exemples pris dans le domaine agricole et, notamment, celui de la Politique agricole commune (Pac).
Ressources naturelles et développement durable (F. Tchapga et M. Yelkouni)
L’objectif du cours est de familiariser l’étudiant.e à l’analyse économique appliquée aux ressources naturelles. Il s’agit, en particulier, de mettre en relief les outils nécessaires pour comprendre les enjeux d’une bonne gestion de ces ressources dans l’atteinte des objectifs du développement durable. Ce cours donne donc des repères fondamentaux en économie des ressources naturelles.
Economie des ménages et des exploitations agricoles (L. Levard)
Les exploitations agricoles constituent les cellules économiques de base de l’agriculture, dans la mesure où c’est à ce niveau que les décisions techniques et économiques liées à la production agricole sont prises et que les processus d’accumulation s’observent généralement (du moins dans le cas des exploitations agricoles familiales). Il importe donc que les professionnels du développement agricole soient en mesure de comprendre et d’interpréter les processus de prise de décision et d’accumulation.
Le cours consacré à l’économie des ménages et des exploitations agricoles a pour objectif de proposer des outils théoriques permettant d’analyser le fonctionnement des exploitations agricoles (et notamment des exploitations familiales), les facteurs influant sur les prises de décision et les différents types de rationalité économique. Il présente également les principaux outils permettant de mesurer les résultats économiques de l’activité économique des ménages (et notamment les résultats de l’exploitation agricole) et les dynamiques d’accumulation (ou de décapitalisation).
Option libre 1
Des options libres cohérentes avec la formation et compatibles avec le planning sont proposées aux étudiant.e.s. Il reste que l’option libre peut être choisie dans l’offre de formation de l’IEDES, ou plus largement de l’université Paris1, ou à l’extérieur de l’université Paris 1, avec l’accord du/de la directeur.trice du parcours.
A l’IEDES, deux cours optionnels « Module tutoré » en Economie et « Initiation à le recherche » en Sciences Humaines et Sociales sont ouverts à tous les étudiant.e.s du M1. N’engageant en rien à une poursuite d’études dans une filière « recherche », leurs objectifs principaux sont de fournir des outils, des méthodes de travail, des "réflexes intellectuels", des savoir-faire afin d’aborder tout travail de recherche, de réflexion personnelle et/ou de rédaction allant au delà des travaux "habituels" ou ordinairement demandés (articles, dossiers documentaires assortis de synthèse, rapports de stage ; mémoires de toutes sortes...).
Cours de Semestre 3 (Master 2)
Politiques agricoles (T. Pouch, M. Raffray)
Ce cours traite de la politique agricole française dans le cadre européen. Il débute par une brève introduction sur les fondements économiques des politiques agricoles. Il se poursuit avec les enjeux de l'agriculture européenne, la genèse et les réformes de la Politique agricole commune, puis les perspectives attendues (critiques de la nouvelle PAC, enjeux liés au développement du 2nd pilier de la PAC...). Il se finit avec les enjeux internationaux de la Politique agricole commune (rôle de l'OMC vis-à-vis de la PAC, impact des accords de libre-échange...).
Études rurales (anthropologie : Jordie Ansari Blanc, Christophe Jacqmin, Abdoulaye Ouédraogo)
Acteurs et organisation du travail dans le monde rural
Ce cours vous propose une analyse de différentes perspectives du changement social dans les milieux ruraux africains et sud-américains. Nous orienterons la thématique de ce séminaire autour des questions agraires, notamment la problématique de la fertilité des sols, des formes d’organisation communautaire, des formes de militantisme et d’appropriation des projets de développement par les acteurs du secteur rural. Le séminaire mobilisera à la fois des sources théoriques, des études de cas, des table-rondes et des documentaires audiovisuels. Le cours se décomposera en trois temps.Les quatre premières séances seront consacrées à une lecture anthropologique des problématiques agraires dans le secteur rural sud-américain. Nous poserons les fondements des études marquantes de ce champ disciplinaire et de leurs auteurs afin d’apporter un éclairage sur les alternatives de développement proposées par les acteurs locaux, les ONG ou encore les politiques publiques. Deux études de cas seront abordées : le système de coopérative et de regroupement villageois comme stratégie d’aide au développement et la production de café et de coca dans les Andes boliviennes. Le documentaire « Une feuille de coca dans les caféiers tourné en 2014 et 2015 en Bolivie » sera projeté. Puis seront développées les dynamiques d’organisation du monde rural ouest-africain et l’importance des réseaux dans le changement social, en se basant sur l’expérience de plus 30 ans de l’ONG Inter-réseaux.
Enfin, les deux dernières séances partiront du constat que dans la plupart des pays d'Afrique, de multiples actions et projets de développement ont été entrepris dans les villages sans apporter de véritables changements en termes de mieux-être des populations. Pourquoi, malgré́ diverses intentions et interventions, les projets échouent-ils le plus souvent dans les villages en Afrique ? La perspective du changement social dans les milieux ruraux africains sera abordée, notamment celle de James J. Scott (2021). Cette perspective suggère que les sociétés rurales résistent à l'État pour changer selon leurs propres savoirs pratiques et savoir-faire issus de la mètis en s'appuyant sur les logiques propres à l'infrapolitique : leadership de l'informel, absence d'élites et discours oral (Scott, 2021). L’intervention alternera présentations théoriques, débats et le visionnage de deux documentaires tournés en milieu rural mossi en 2023 (Burkina Faso).
Inclue dans le séminaire : Table –Ronde « Préserver le fertilité des sols en Afrique : un enjeu fertile ». Cité du développement durable. Événement FARM/Inter-Réseaux
Anticiper et baliser l’avenir ; l’usage des prospectives (E. Valceschini)
Les prospectives, qu’elles soient nationales, européennes ou internationales, se sont multipliées au cours des quinze dernières années. Pourtant, aujourd’hui plus que jamais, il est particulièrement difficile de se projeter dans l’avenir, tellement celui-ci nous apparaît criblé d’incertitudes. La prospective n’est pas seulement un projet et une méthode pour penser le futur, c’est aussi et surtout une manière de déterminer les actions présentes. Plus qu’un outil, la prospective est avant tout une représentation du monde. A partir de la décennie 1970, la prospective s’est engagée dans une voie qui prend à son compte les problèmes posés par la globalisation. La conscience de l’interdépendance planétaire, tissée de l’essor des technologies, de la mondialisation de l’économie, des inquiétudes liées aux approvisionnements en ressources de base et des atteintes à l’environnement, a fait le lit du développement des modèles mondiaux qui ont perdu de leur pouvoir d’inspiration et d’influence auprès des décideurs publics dans les années 1980 et 1990. Cette tendance s’inversera dans les années 2000, au moment où les enjeux globaux de sécurité alimentaire, de transition énergétique ou ceux liés au changement climatique rendent nécessaires de considérer certains phénomènes ou certaines actions sur le long terme et dans le cadre d’une coopération internationale.
S’appuyant sur une panoplie de méthodes et d’outils (consultations d’experts, modélisations, scénarios…), la prospective cherche à déterminer les conséquences sur notre avenir de nos actions passées et à venir, avec une ambition : se défaire des idées de ce même passé pour mieux affronter l’avenir, voire s’en rendre maître. Elle privilégie l’élaboration de scénarios qui permettent d’explorer les ruptures envisageables, les basculements d’une logique à une autre, ce qui, in fine, conduit à la construction d’histoires possibles pour le futur. Mais la prospective peut-elle encore être à la hauteur de cette ambition dans le monde d’aujourd’hui ? N’est-elle pas lestée par la priorité donnée aux stratégies d’adaptation privilégiant la réactivité et la flexibilité, au point de n’agir que dans le présent, le court terme ? A l’heure actuelle, la prospective n’est plus seulement confrontée à la question des données, des outils et des méthodes. Elle est aussi interrogée sur sa vision de l’histoire : sur la manière dont elle rend compte de l’état présent comme aboutissement d’un processus historique et comme point de passage vers diverses voies possibles vers le futur.
L’enseignement suivra trois axes de travail indicatifs :
- Histoire de la prospective et de ses usages dans le mouvement d’internationalisation et de mondialisation de l’économie depuis la seconde guerre mondiale.
- Les principales prospectives et ses acteurs politiques, économiques et scientifiques : contenu et point de vue critique.
- Les prospectives, le développement économique et la sécurité alimentaire mondiale au cours de vingt dernières années.
Dynamique des systèmes agraires (S. Bainville)
Cet enseignement vise tout d’abord à sensibiliser les étudiant.e.s à l’importance de l’agriculture dans le développement économique. En second lieu, en tant qu’objet complexe, l’agriculture suppose de disposer de concepts et de méthodes adaptés à son analyse, ces outils seront aussi présentés. Suivant la nature des écosystèmes et suivant les événements historiques qui en ont ponctué l’évolution, les systèmes agraires sont aujourd’hui des plus divers dans le monde. Les cours porteront sur quelques systèmes agraires (Europe occidentale, Amérique Latine et Afrique de l’Ouest principalement), leurs évolutions, leurs caractéristiques et les conséquences qui en résultent pour le développement économique global. Les travaux dirigés seront l’occasion pour les étudiant.e.s de présenter un exemple de système agraire sous forme d’un dossier qui sera exposé oralement.
Modélisation des données (agriculture, climat ...) (E. Delesalle, C. Guénard)
Ce cours à visée méthodologique porte sur les systèmes d’information permettant de renseigner les conditions de production agricole et constitue une initiation au traitement statistique (statistiques descriptives, bases économétriques, représentations graphiques) de données d’enquêtes agricoles et/ou d’observations environnementales à travers l’utilisation d’un logiciel de traitement de données.
Gestion durable et équitable des produits agro-forestiers (Y. Fare, A. Hétroit, K. Houngbedji, B. Jobbé-Duval, G. Moynot, M. Rivière, J. Stoll)
Il est communément reconnu que les forêts et les arbres apportent une contribution vitale à la population et à la planète. La forêt contribue à faire face au changement climatique en séquestrant le carbone, stabilisant les sols, régulant les cours d’eau et en hébergeant une part importante de la biodiversité terrestre. La forêt constitue aussi une source de nourriture, de médicaments, d’énergie, de revenu et participe à la sécurité alimentaire de plusieurs communautés. Enfin, la forêt est complémentaire des activités agricoles car elle offre un habitat pour les pollinisateurs et les ennemis naturels des ravageurs d’importance agricole.
A ces égards, certains usages de la forêt (comme les plantations, les terrains agricoles, l'extraction d'essences forestières ou la production de bois de chauffe, d’industrie ou de construction) soulèvent la question de l'arbitrage entre les bénéfices tirés de l'exploitation de la forêt pour les générations présentes et leurs impacts de moyen et long terme sur les conditions de vie des générations futures, le changement climatique et la biodiversité. Cet arbitrage est particulièrement délicat car il repose sur plusieurs aspects de gouvernance qui peuvent en menacer l'efficacité. Il s’agit par exemple de choisir qui a le droit d’exploiter une forêt (les populations locales ou des industries extractives souvent d'origine étrangère) et comment partager les revenus tirés de l’exploitation. Ensuite, décider de l'usage de la forêt revient aussi à ce que les générations présentes mettent en œuvre des politiques qui limitent leurs usages des forêts au profit des générations futures. Autrement dit, certaines communautés à faibles revenus, devront renoncer aux bénéfices qu'ils pourraient tirer de l'usage des ressources forestières auxquelles elles ont accès afin de préserver les services que ces dernières pourraient produire dans un futur incertain. Or, lorsque les personnes qui prennent les décisions bénéficient des avantages mais ne supportent pas une part proportionnelle des coûts, il est peu probable que les décisions soient optimales du point de vue de la société.
Ce cours revient sur les enjeux posés par l’exploitation durable des ressources agro-forestières. Nous ferons l’inventaire des acteurs présents, étudierons les différents modes de gestion qui existent ainsi que les politiques publiques, explorerons leurs fondements théoriques et objectifs puis présenterons l’état de l’art quant à leur efficacité. Des focus seront également réalisés par grandes régions géographiques (ex. climat tempéré, climat tropical...).
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à choisir 1 cours parmi les 3 cours suivants qui ont une orientation « recherche » respectivement en sociologie, en géographie, en économie.
1. Sociologie des politiques publiques : le développement durable (sociologie : R. Cussó)
L’analyse de la définition, de la conception et de la mise en œuvre du développement durable est très pertinente tant les échelons de décision et les pratiques sont variées. En même temps, le développement durable peut être appréhendé comme un phénomène politique qui fait « système ». Ce cours vise à introduire les étudiants à la sociologie des politiques publiques et à la sociologie de l’action collective. Le développement durable est, d’abord, considéré à partir de sa promotion à l’échelon global (organisations internationales, grands objectifs et programmes…) pour analyser ensuite sa pratique méso et locale plus concrète (institutions nationales, ONG, projets, évaluations…). Une attention particulière sera portée au rôle des acteurs (experts, professionnels, population « cible »). Les étudiants acquièrent des connaissances sur le développement durable « en situation », dans l’étude de l’articulation entre les structures (organismes) qui le portent et les acteurs (professionnels ou autres) qui l’incarnent. Ils développent une recherche tout au long du semestre, comprenant la mise en œuvre d’un entretien suite à une formation sur cette méthode à la fois de recherche et professionnelle.
Objectifs :
• Introduire à la sociologie des politiques publiques et à la sociologie de l’action collective dans le contexte du développement durable.
• Analyser une agence, une ONG, etc. travaillant dans le domaine du DD –éventuellement étudier un mouvement de défense de l’environnement, un syndicat paysan, etc.
• Analyser le travail / l’activité d’un expert, d’un professionnel du développement durable.
• Développer une vision à la fois politique critique et en situation du développement durable.2. Crises alimentaires africaines : objet, dimensions et analyses (géographie : P. Janin, coord.)
La vulnérabilité des sociétés et des territoires, aux changements et aux aléas, de même que la notion de crise, est au cœur de la problématique de ce cours. Leur analyse s’appuie sur un ensemble de recherches menées en milieu rural comme en ville, dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, mobilisant des approches méthodologiques variées, tout en élargissant les enseignements par de nombreux documents secondaires. « Vulnérabilité » et « crise » sont à envisager à différentes échelles spatiales et temporelles afin d’en saisir toutes les dimensions et les facettes.
En dépit des idées reçues ou des parti pris qu’elles véhiculent, elles s’avèrent fécondes pour comprendre et analyser la complexité des questions alimentaires : agro-environnementales certes, géoéconomiques sans aucun doute, nutritionnelles également mais plus encore sociétales et politiques. L’inégale vulnérabilité à l’insécurité s’explique principalement par un déficit de ressources (alimentaires ou monétaires) et par une perte de capacité d’accès (économique et sociétale) dans un environnement aléatoire et incertain. Elle peut être étudiée selon plusieurs angles : déterminants, héritages, contextes, interactions, trajectoires.
La variabilité de l’insécurité alimentaire est plus particulièrement renseignée par l’analyse des pratiques de gestion des pénuries alimentaires (réactions familiales, réponses institutionnelles), des discours et des perceptions du risque permettant de délimiter la notion de crise comme de penser et de légitimer les actions à mettre en oeuvre. Pour tenter de faire face au risque de faim, sociétés locales et développeurs ont recours, depuis la période coloniale, à différentes stratégies de lutte (stocker, importer et produire plus), aux succès partiels et contingents, dont la gouvernance du risque et des ressources localisés constitue une des nouvelles frontières.
Précarité, vulnérabilité et inégalités, accrues en période de crise, sont également matière à redéfinir la place et le rôle respectif des acteurs. Dans un contexte d’instabilité des prix, de raréfaction des ressources et de recomposition des sociabilités, l’insécurité alimentaire et les crises qui les accompagnent parfois est désormais plus aléatoire et plus diffuse ; plus urbaine et davantage médiatisée, elle préoccupe également gouvernants et développeurs par la conflictualité potentielle qu’elle génère. De nouvelles tensions apparaissent également en milieu rural, là où la faim de terres, pour la production d’agro-carburants ou de ressources vivrières, inquiète et mobilise. Au demeurant, c’est donc bien la question des modèles de développement agricole (à promouvoir ou éviter) et des politiques à refondre, qui est brutalement reposée.
La crise alimentaire de 2007-2008, par sa brutalité et son ampleur, a rappelé la vulnérabilité de certains États importateurs et des sociétés urbaines. Elle a remis en exergue le potentiel mobilisateur de la faim. De fait, la lutte contre la faim semble avoir changé de paradigme et d’échelle. Elle ne revêt plus seulement des objectifs économiques et techniques (lutter contre la précarité, la malnutrition et la pauvreté) mais possède aussi une indéniable dimension politique (réduire les inégalités, dire les droits) et géopolitique (coordonner les luttes, moduler les rapports de force).
On peut ainsi avancer l’hypothèse d’une véritable administration de la faim par ses règlements, ses pratiques et ses dispositifs de contrôle. Dans le même ordre d’idée, on peut aussi penser que la validation des savoirs et leur diffusion constituent un enjeu central de la légitimation des interventions de toute nature. Au-delà des analyses technocratiques convenues comme des discours militants mobilisateurs, la sécurisation alimentaire est donc affaire de pouvoir.
Les différentes séances aborderont notamment les points suivants :
- les concepts d’aléa, de risque, d’insécurité et de vulnérabilité ;
- les facettes du manque alimentaire ;
- les dimensions théoriques, historiques et conceptuelles des crises ;
- les outils de diagnostic et les politiques de lutte ; les méthodologies d’enquête de terrain ;
- l’hétérogénéité des acteurs impliqués et les effets des interventions ;
- la politisation et la médiatisation de la faim.
3. Travail, compétences, réseaux et trajectoires dans les pays en développement : Méthodes et résultats de recherche (économie : C.J. Nordman et C. Gironde)
Ce séminaire a vocation à présenter des problématiques, des méthodes et des résultats de recherches portant sur les questions du travail, des compétences, des réseaux sociaux et des trajectoires dans les pays en développement.
La question du travail et des diverses inégalités qui lui sont associées ont en effet été placées sous le feu des projecteurs de la recherche et des politiques de développement, notamment dans les rapports internationaux publiés par les organisations internationales depuis 12 ans. Mais des programmes de recherche novateurs ont été développés sur ces champs depuis plus de 20 ans, et n'ont donc pas attendu que la communauté des bailleurs internationaux s'en empare.
Ce cours en présente les enjeux et propose une initiation à la recherche, par une incursion dans la pratique même de la recherche, ses terrains, ses collectes de données, et ses difficultés.
Le séminaire sera conclu par la présentation d'un programme de recherche intégré sur ces thèmes, et par des projections de documentaires scientifiques sur ce champ, qui est coordonné actuellement en Inde du Sud par C.J. Nordman. Les deux dernières séances seront consacrées à d’autres terrains de recherche en Asie.
Projets de développement : suivi financier (Y. Makrouf)
L’élaboration des budgets, la programmation du décaissement des fonds alloués aux projets, le suivi et le « reporting » financier sont des compétences nécessaires à tout gestionnaire de projet. Il s’agira de comprendre les processus financiers, les obligations des opérateurs, les spécificités des bailleurs et d’appliquer des méthodes éprouvées par les professionnels de projets de développement local. Ce cours sera animé par Gilles Goldstein, chargé de programme de l’IRAM, Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement.
Projets de développement : cycle de projet et évaluation (R. Lurois)
L’objectif de ce cours est double. Il s’agit d’abord de comprendre et d’acquérir les fondamentaux en matière de gestion de projets de développement, à travers les principes, méthodes et outils liés au cycle de projet. Ensuite, le module questionnera les enjeux transversaux, en particulier environnementaux et sociaux, des projets de développement, et la manière dont ces enjeux peuvent et doivent être pris en compte dans l’élaboration et la conduite de projets de développement. Ce cours combinera apports académiques, retours d’expérience et exercices pratiques, en s’appuyant sur des exemples concrets de projets de développement agricole et rural.
Agronomie (J. Roger-Estrade)
Ce cours procure les bases pour comprendre les grands processus à l’œuvre dans un champ cultivé et sur lesquels l’agriculteur agit par ses techniques culturales. On y présente les éléments qui permettent de comprendre les bases du raisonnement de ces techniques, quel que soit le type d’agriculture dans laquelle elles s’appliquent. Les principes de l’agroécologie sont également abordés.
Zootechnie (V. Berthelot)
Ce cours présente les bases de la zootechnie et dote les étudiant.e.s d’un « bagage minimum » en la matière dans la même perspective que le cours d’agronomie.
Systèmes d’information Géographique - SIG (B. Toulouse)
L’informatique est désormais incontournable dans tous les métiers et la maîtrise de logiciels techniques est indispensable sur le marché de l’emploi. Il s’agit au cours des séances d’initier les étudiant.e.s à l’utilisation du logiciel "Quantum GIS" (logiciel libre, SIG - Analyse spatiale - traitement de bases de données et d'images spatiales) et aux solutions de mise en valeur de leurs travaux (Carte - Poster - Schéma - Rapport). Les cours sont partagés entre des séances d’enseignement théorique et des séances de pratique sur les logiciels.
-
Débouchés
Le parcours « développement agricole » vise à former des professionnel.le.s de terrain – chargé.e.s d’études, agroéconomistes, cadres généralistes, gestionnaires, coordinateurs.trices, évaluateurs.trices, consultant.e.s – destiné.e.s à travailler dans les ONG de développement, dans les bureaux d’études et dans le cadre de la coopération décentralisée mais aussi dans les institutions nationales, européennes ou internationales.
Les diplômé.e.s du parcours ont vocation à intégrer :
- des chambres professionnelles, des administrations dédiées à l'agriculture et au monde rural (nationales, territoriales ou locales), des instituts techniques agricoles
- des agences et services de coopération internationale (par ex. AFD, MEAE)
- des agences et services de l’environnement et du développement durable
- des organisations non gouvernementales (ONG), nationales ou internationales chargées d’actions de développement intégré en milieu rural, de lobbying (par ex. GRET, IRAM, OXFAM, AGTER, AVSF, FARM)
- des organisations européennes ou internationales (ex. EUROPAID, FAO, PAM, CGIAR)
- des bureaux d’études, entreprises privés et cabinets d’experts intervenant sur des programmes de développement économique en milieu rural ou sur des interventions sectorielles (services et aides aux agriculteurs, promotion des PME de commerce équitable, mise en place de coopératives, promotion de l’agroécologie et/ou de l’agriculture biologique, modernisation du secteur agricole, adduction d’eau, etc.)
- des réseaux (Inter-réseaux, réseaux des AMAP, FADEAR etc.)

Jardin d’agronomie tropicale de Paris
Charlotte Guénard, Maître de conférences en économie
Pour toute question administrative : scoliedes@univ-paris1.fr
Institut d'études du développement de la Sorbonne (IEDES)
Parcours Développement agricole et politiques économiques